« Porter assistance » aux pauvres du monde
Thomas Pogge, Professeur de philosophie à l’Université de Columbia aux États-Unis. Parmi ses publications, signalons : Realizing Rawls (Cornell University Press, 1989) et World Poverty and Human rights (Polity Press, 2002).
source : http://www.inegalites.fr/
Nous, citoyens des pays prospères, avons tendance à discuter de nos obligations à l’égard de ceux qui, au loin, sont dans le besoin en termes de dons et de transferts, d’assistance et de redistribution : Quelle part de notre richesse devrions-nous, le cas échéant, donner à ceux qui, à l’étranger, meurent de faim ? En m’appuyant sur la façon dont un théoricien de premier plan conçoit le problème, je montrerai que cela constitue en fait une erreur sérieuse – et qui plus est une erreur que les pauvres dans le monde paient très cher. Dans son ouvrage, Le Droit des gens, John Rawls ajoute, par rapport à la façon dont il avait traité antérieurement de la question, une huitième loi : « Les peuples ont le devoir d’assister les autres peuples vivant dans des conditions défavorables qui les empêchent de disposer d’un régime social et politique juste ou convenable ». 1 Par cet ajout, il entend montrer qu’il est possible, à partir de sa théorie de la justice, de justifier une représentation – qui demeure moins égalitaire que celle que ses critiques cosmopolites l’enjoignaient d’adopter – de la justice économique globale. 2 Ce devoir nouvellement ajouté est cependant d’une portée qui est à la fois trop grande pour que Rawls soit en mesure de le justifier et d’une portée trop faible pour qu’il puisse résoudre à lui seul le problème de la pauvreté dans le monde. lire la suite
ISLAM ET POLITIQUE:"rien ne naît de rien"
"Nulle contrainte en religion !" (Le Coran, 2-256)
source : http://www.acontresens.com/
L'importance actuelle des mouvements politiques radicaux se réclamant de l'islam, ainsi que la "visibilité" croissante des musulmans dans les pays européens, placent l'islam au centre de nombreux débats politiques, au sein de certains pays et sur la scène internationale (où règne le poids écrasant du discours axiologique américain). Or, l'exposition médiatique et politique de la religion musulmane en donne une vision réductrice et simplificatrice : cette vision est celle d'une religion fondamentalement politique, à l'emprise absolue sur les individus qui la pratiquent, et animée d'une prétention de prise en charge religieuse des sociétés et des Etats. Le récent exemple français du "débat" autour du port du voile islamique à l'école en témoigne : que toute femme portant le voile soit indubitablement considérée par certains comme une victime de l'oppression masculine ou comme un agent de prosélytisme dangereux, une certitude émerge : l'islam est une religion suspecte. Suspecte car les pires régimes politiques actuels s'en réclament (Arabie Saoudite, Iran, Soudan, etc.), tout comme des mouvements extrémistes porteurs de chaos (Al-Qaida, Hamas) ; suspecte aussi, et bien évidemment, pour des raisons propres aux sociétés occidentales, traversées par des vents racistes en réaction au multiculturalisme et par une mauvaise digestion des passés coloniaux.
Mais peut-on, parce que des groupes ou individus se réclamant de l'islam en font un instrument politique, se faire aussi affirmatif sur une soi-disant essence de l'islam, qui en ferait une religion fondamentalement différente des autres ? Doit-on considérer le Coran, qui fournit les arguments les plus efficaces aux extrémistes religieux (autour des notions de shari'a, de jihad, etc.), comme un livre générateur en lui-même d'une doctrine politique, d'un système institutionnel de domination autoritaire et anti-démocratique, sur les individus comme sur les sociétés ? Surtout, n'est-ce pas une grave erreur que de parler de l'islam comme d'une entité désincarnée et existant au-delà des individus, en rayant sa diversité spatiale et temporelle ?
Ces questions montrent à quel point une réflexion sur l'islam a besoin d'histoire. Non pas qu'une connaissance précise de l'histoire de l'islam permette de tout expliquer, de changer les regards ou d'enrayer le radicalisme religieux. Mais elle peut s'avérer nécessaire pour désamorcer l'aura mystique qui entoure toutes les religions et notamment leur naissance, comme si elles n'étaient pas avant tout des faits terrestres, ancrés dans des contextes politiques, économiques et sociaux, et vécus par les hommes. Une sérénité face aux religions ne peut qu'être bénéfique pour les appréhender, en évitant les écueils généralisateurs habituels, naïfs ("les religions sont responsables de tous les maux", "l'islam est une religion tolérante et pacifique") et dangereux ("l'islam est incompatible avec la modernité, la démocratie, la laïcité").
Ainsi, le parcours historique que nous proposons permettra d'abord de contester l'idée d'une essence politique de l'islam, en contextualisant les premiers temps de la religion et en analysant quelques éléments essentiels du Coran (à partir d'une synthèse d'éléments repris notamment dans l'ouvrage récent de Mohamed-Chérif Ferjani, Le politique et le religieux dans le champ islamique). Puis nous suivrons les évolutions historiques des instrumentalisations politiques de la religion musulmane (en distinguant les époques, les lieux, les obédiences) qui ont conduit jusqu'aux mouvements contemporains d'islam politique (l'islam politique, c'est-à-dire l'utilisation de l'islam à des fins politiques, étant ce qu'il convient proprement de nommer islamisme). Avec en tête une évidence : rien ne naît de rien.
lire la suite
Thomas Pogge, Professeur de philosophie à l’Université de Columbia aux États-Unis. Parmi ses publications, signalons : Realizing Rawls (Cornell University Press, 1989) et World Poverty and Human rights (Polity Press, 2002).
source : http://www.inegalites.fr/
Nous, citoyens des pays prospères, avons tendance à discuter de nos obligations à l’égard de ceux qui, au loin, sont dans le besoin en termes de dons et de transferts, d’assistance et de redistribution : Quelle part de notre richesse devrions-nous, le cas échéant, donner à ceux qui, à l’étranger, meurent de faim ? En m’appuyant sur la façon dont un théoricien de premier plan conçoit le problème, je montrerai que cela constitue en fait une erreur sérieuse – et qui plus est une erreur que les pauvres dans le monde paient très cher. Dans son ouvrage, Le Droit des gens, John Rawls ajoute, par rapport à la façon dont il avait traité antérieurement de la question, une huitième loi : « Les peuples ont le devoir d’assister les autres peuples vivant dans des conditions défavorables qui les empêchent de disposer d’un régime social et politique juste ou convenable ». 1 Par cet ajout, il entend montrer qu’il est possible, à partir de sa théorie de la justice, de justifier une représentation – qui demeure moins égalitaire que celle que ses critiques cosmopolites l’enjoignaient d’adopter – de la justice économique globale. 2 Ce devoir nouvellement ajouté est cependant d’une portée qui est à la fois trop grande pour que Rawls soit en mesure de le justifier et d’une portée trop faible pour qu’il puisse résoudre à lui seul le problème de la pauvreté dans le monde. lire la suite
ISLAM ET POLITIQUE:"rien ne naît de rien"
"Nulle contrainte en religion !" (Le Coran, 2-256)
source : http://www.acontresens.com/
L'importance actuelle des mouvements politiques radicaux se réclamant de l'islam, ainsi que la "visibilité" croissante des musulmans dans les pays européens, placent l'islam au centre de nombreux débats politiques, au sein de certains pays et sur la scène internationale (où règne le poids écrasant du discours axiologique américain). Or, l'exposition médiatique et politique de la religion musulmane en donne une vision réductrice et simplificatrice : cette vision est celle d'une religion fondamentalement politique, à l'emprise absolue sur les individus qui la pratiquent, et animée d'une prétention de prise en charge religieuse des sociétés et des Etats. Le récent exemple français du "débat" autour du port du voile islamique à l'école en témoigne : que toute femme portant le voile soit indubitablement considérée par certains comme une victime de l'oppression masculine ou comme un agent de prosélytisme dangereux, une certitude émerge : l'islam est une religion suspecte. Suspecte car les pires régimes politiques actuels s'en réclament (Arabie Saoudite, Iran, Soudan, etc.), tout comme des mouvements extrémistes porteurs de chaos (Al-Qaida, Hamas) ; suspecte aussi, et bien évidemment, pour des raisons propres aux sociétés occidentales, traversées par des vents racistes en réaction au multiculturalisme et par une mauvaise digestion des passés coloniaux.
Mais peut-on, parce que des groupes ou individus se réclamant de l'islam en font un instrument politique, se faire aussi affirmatif sur une soi-disant essence de l'islam, qui en ferait une religion fondamentalement différente des autres ? Doit-on considérer le Coran, qui fournit les arguments les plus efficaces aux extrémistes religieux (autour des notions de shari'a, de jihad, etc.), comme un livre générateur en lui-même d'une doctrine politique, d'un système institutionnel de domination autoritaire et anti-démocratique, sur les individus comme sur les sociétés ? Surtout, n'est-ce pas une grave erreur que de parler de l'islam comme d'une entité désincarnée et existant au-delà des individus, en rayant sa diversité spatiale et temporelle ?
Ces questions montrent à quel point une réflexion sur l'islam a besoin d'histoire. Non pas qu'une connaissance précise de l'histoire de l'islam permette de tout expliquer, de changer les regards ou d'enrayer le radicalisme religieux. Mais elle peut s'avérer nécessaire pour désamorcer l'aura mystique qui entoure toutes les religions et notamment leur naissance, comme si elles n'étaient pas avant tout des faits terrestres, ancrés dans des contextes politiques, économiques et sociaux, et vécus par les hommes. Une sérénité face aux religions ne peut qu'être bénéfique pour les appréhender, en évitant les écueils généralisateurs habituels, naïfs ("les religions sont responsables de tous les maux", "l'islam est une religion tolérante et pacifique") et dangereux ("l'islam est incompatible avec la modernité, la démocratie, la laïcité").
Ainsi, le parcours historique que nous proposons permettra d'abord de contester l'idée d'une essence politique de l'islam, en contextualisant les premiers temps de la religion et en analysant quelques éléments essentiels du Coran (à partir d'une synthèse d'éléments repris notamment dans l'ouvrage récent de Mohamed-Chérif Ferjani, Le politique et le religieux dans le champ islamique). Puis nous suivrons les évolutions historiques des instrumentalisations politiques de la religion musulmane (en distinguant les époques, les lieux, les obédiences) qui ont conduit jusqu'aux mouvements contemporains d'islam politique (l'islam politique, c'est-à-dire l'utilisation de l'islam à des fins politiques, étant ce qu'il convient proprement de nommer islamisme). Avec en tête une évidence : rien ne naît de rien.
lire la suite
L'Investissement Ethique
source: http://www.exquiro.com
Investir "éthique", c'est prendre en compte d'autres facteurs que les seules performances économiques et financières pour ses placements.
Les investisseurs "éthiques" se préoccupent évidemment de la rentabilité de leurs placements, mais aussi de la politique sociale et environnementale menée par les entreprises dont ils détiennent des actions ...
Tout commença aux Etats-Unis dans les années 20. Après avoir longtemps refusé de mettre son l'argent en Bourse, l'église méthodiste se décida à y investir mais en s'assurant que son argent ne profita ni à des fabricants d’alcool ni à des entreprises «dévoyées».
Mais ce fut réellement dans les années 60 qu’apparut la notion d’«investissement socialement responsable» : des citoyens américains, opposés à la guerre du Vietnam, décidèrent de boycotter la société qui produisait le napalm.
C'est aujourd'hui un marché en pleine expansion : aux États-Unis, un dollar sur dix est investi en fond éthique : soit plus de 1.800 milliards de dollars.
Les fonds éthiques investissent dans des entreprises qui respectent l'environnement et les droits des travailleurs et rejètent principalement l'industrie militaire, le nucléaire, les manufacturiers de tabac ou d'alcool.
Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous conseillons de visiter le site Novethic qui traite de façon très détaillée ce sujet.
Novethic identifie trois grandes familles de placements : les fonds éthiques, les fonds de partage, et les produits financiers solidaires.
Extraits :
*Les Fonds Ethiques : pour l'essentiel, ils sont composés d'actions d'entreprises bien notées sur un plan social et environnemental.
Une cinquantaine de fonds éthiques sont disponibles sur le marché français. Les fonds dits de développement durable sont composés de valeurs bien notées par les agences de notation sociales et environnementales.
Certains fonds peuvent aussi appliquer des critères d'exclusion (secteur de l'armement, de l'alcool, du tabac, etc.) pour des raisons éthiques ou religieuses.
Les fonds éthiques s'adressent à des investisseurs au profil dynamique parce qu'ils sont majoritairement composés d'actions.
* Les Fonds de Partage : leurs souscripteurs reversent une partie de leurs bénéfices à l'association caritative à laquelle le fonds est dédié.
Il existe une dizaine de fonds de partage sur le marché français. Ils sont majoritairement placés en obligations.
Dans la mesure où les bénéfices sont reversés, pour tout ou partie, à des actions et des organismes caritatifs, les fonds de partage s'adressent à des investisseurs, soucieux de soutenir " la cause " qu'ils contribuent ainsi à financer.
* Les Produits Financiers Solidaires : Il s'agit de placements servant à financer des projets d'utilité sociale. Une trentaine de produits financiers solidaires sont disponibles en France. Il s'agit de livrets d'épargne, Codevi, compte à terme...investis dans des entreprises d'insertion, de micro crédits ou autre projets solidaires.
Ils s'adressent à des investisseurs qui souhaitent que le produit de leur épargne serve à des projets qui ne trouvent pas de financement dans les circuits bancaires traditionnels.
en savoir plus
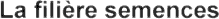
source : http://www.gnis.fr/
De la création de nouvelles variétés à leur commercialisation : comment fonctionne la filière semences ? Comment interviennent les étapes intermédiaires d'inscription au catalogue et de contrôle de la qualité ? Partez à la découverte de la filière semences
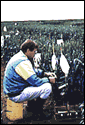 1ère phase :
1ère phase :
De la création à la commercialisation
La création de nouvelles variétés est longue et demande des moyens de plus en plus importants. Il existe en France une centaine d'Etablissements obtenteurs (de variétés végétales) dans lesquels travaillent les scientifiques qui cherchent à créer de nouvelles variétés. Ils travaillent souvent en collaboration, pour la recherche fondamentale, avec des organismes publics tels que l'INRA.
A partir de variétés déjà existantes et de plantes sauvages, les chercheurs procèdent à différents types de croisements et s'aident de nouvelles techniques, notamment celles issues des biotechnologies, pour obtenir des variétés améliorées présentant de nouvelles caractéristiques intéressantes. Des variétés plus résistantes aux maladies ou aux parasites, mieux adaptées aux conditions de sols et de climat, plus productives, ayant des caractéristiques technologiques intéressantes pour l'industrie et l'alimentation sont obtenues chaque année pour de nombreuses espèces cultivées. Les gains obtenus sont considérables : le rendement du blé a triplé en quarante ans en France, le maïs, plante d'origine tropicale, ne cesse de remonter vers le Nord, la composition du colza a été transformée pour produire une huile de grande qualité.lire la suite
source: http://www.exquiro.com
Investir "éthique", c'est prendre en compte d'autres facteurs que les seules performances économiques et financières pour ses placements.
Les investisseurs "éthiques" se préoccupent évidemment de la rentabilité de leurs placements, mais aussi de la politique sociale et environnementale menée par les entreprises dont ils détiennent des actions ...
Tout commença aux Etats-Unis dans les années 20. Après avoir longtemps refusé de mettre son l'argent en Bourse, l'église méthodiste se décida à y investir mais en s'assurant que son argent ne profita ni à des fabricants d’alcool ni à des entreprises «dévoyées».
Mais ce fut réellement dans les années 60 qu’apparut la notion d’«investissement socialement responsable» : des citoyens américains, opposés à la guerre du Vietnam, décidèrent de boycotter la société qui produisait le napalm.
C'est aujourd'hui un marché en pleine expansion : aux États-Unis, un dollar sur dix est investi en fond éthique : soit plus de 1.800 milliards de dollars.
Les fonds éthiques investissent dans des entreprises qui respectent l'environnement et les droits des travailleurs et rejètent principalement l'industrie militaire, le nucléaire, les manufacturiers de tabac ou d'alcool.
Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous conseillons de visiter le site Novethic qui traite de façon très détaillée ce sujet.
Novethic identifie trois grandes familles de placements : les fonds éthiques, les fonds de partage, et les produits financiers solidaires.
Extraits :
*Les Fonds Ethiques : pour l'essentiel, ils sont composés d'actions d'entreprises bien notées sur un plan social et environnemental.
Une cinquantaine de fonds éthiques sont disponibles sur le marché français. Les fonds dits de développement durable sont composés de valeurs bien notées par les agences de notation sociales et environnementales.
Certains fonds peuvent aussi appliquer des critères d'exclusion (secteur de l'armement, de l'alcool, du tabac, etc.) pour des raisons éthiques ou religieuses.
Les fonds éthiques s'adressent à des investisseurs au profil dynamique parce qu'ils sont majoritairement composés d'actions.
* Les Fonds de Partage : leurs souscripteurs reversent une partie de leurs bénéfices à l'association caritative à laquelle le fonds est dédié.
Il existe une dizaine de fonds de partage sur le marché français. Ils sont majoritairement placés en obligations.
Dans la mesure où les bénéfices sont reversés, pour tout ou partie, à des actions et des organismes caritatifs, les fonds de partage s'adressent à des investisseurs, soucieux de soutenir " la cause " qu'ils contribuent ainsi à financer.
* Les Produits Financiers Solidaires : Il s'agit de placements servant à financer des projets d'utilité sociale. Une trentaine de produits financiers solidaires sont disponibles en France. Il s'agit de livrets d'épargne, Codevi, compte à terme...investis dans des entreprises d'insertion, de micro crédits ou autre projets solidaires.
Ils s'adressent à des investisseurs qui souhaitent que le produit de leur épargne serve à des projets qui ne trouvent pas de financement dans les circuits bancaires traditionnels.
en savoir plus
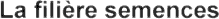
source : http://www.gnis.fr/
De la création de nouvelles variétés à leur commercialisation : comment fonctionne la filière semences ? Comment interviennent les étapes intermédiaires d'inscription au catalogue et de contrôle de la qualité ? Partez à la découverte de la filière semences
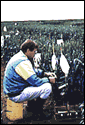 1ère phase :
1ère phase : De la création à la commercialisation
La création de nouvelles variétés est longue et demande des moyens de plus en plus importants. Il existe en France une centaine d'Etablissements obtenteurs (de variétés végétales) dans lesquels travaillent les scientifiques qui cherchent à créer de nouvelles variétés. Ils travaillent souvent en collaboration, pour la recherche fondamentale, avec des organismes publics tels que l'INRA.
A partir de variétés déjà existantes et de plantes sauvages, les chercheurs procèdent à différents types de croisements et s'aident de nouvelles techniques, notamment celles issues des biotechnologies, pour obtenir des variétés améliorées présentant de nouvelles caractéristiques intéressantes. Des variétés plus résistantes aux maladies ou aux parasites, mieux adaptées aux conditions de sols et de climat, plus productives, ayant des caractéristiques technologiques intéressantes pour l'industrie et l'alimentation sont obtenues chaque année pour de nombreuses espèces cultivées. Les gains obtenus sont considérables : le rendement du blé a triplé en quarante ans en France, le maïs, plante d'origine tropicale, ne cesse de remonter vers le Nord, la composition du colza a été transformée pour produire une huile de grande qualité.lire la suite
